COMMUN(S) - VERS UNE POÉTIQUE DES LIEUX INTERMÉDIAIRES | JULES DESGOUTTE · JANVIER 2016
Le forum national de Mantes la Jolie, auquel a contribué ARTfactories/Autre(s)pARTs, s’est tenu au Collectif 12, sur une initiative du réseau francilien Actes If. Il a réuni 160 lieux. Avec la naissance de la Coordination Nationale des Lieux Intermédiaires et Indépendants (CNLII), cet événement est constitutif d’un élargissement majeur de la conscience collective de ces lieux et de leurs acteurs quant à leur identité propre et à l’importance de leur mouvement. La charte de la CNLII traduit cette prise de conscience encore naissante en un certain nombre d’objectifs et d’engagements communs.
Je voudrais la prolonger de quelques réflexions qui m’ont accompagné tout au long du processus de sa rédaction, que le sociologue P.Henry et moi-màªme avons mené conjointement, au sein du comité de pilotage de la coordination nationale, en tant que membres d’ARTfactories/Autre(s)pARTs. La notion d’intermédiation, telle qu’elle apparaît dans "Lieux Intermédiaires", est issue du rapport Lextrait (juin 2001), rapport qui a nourri nos échanges et participé de la dynamique originelle de notre association. Plateforme d’échanges et de réflexion, elle fà »t l’incubatrice de cette notion : elle est la mémoire de la conscience collective qui s’y rattache aujourd’hui, en màªme temps que le dépositaire de l’histoire de ces lieux.
C’est en son nom que je m’adresse, dans le texte qui suit, à la CNLII, et par-delà à tous les lieux, à toutes les expériences d’art et de culture qui en partagent l’héritage - un héritage qui n’est précédé d’aucun testament, comme le dirait Claude Renard, en citant René Char -, avec pour objet d’en renforcer la communauté nouvelle en tâchant de la situer historiquement.
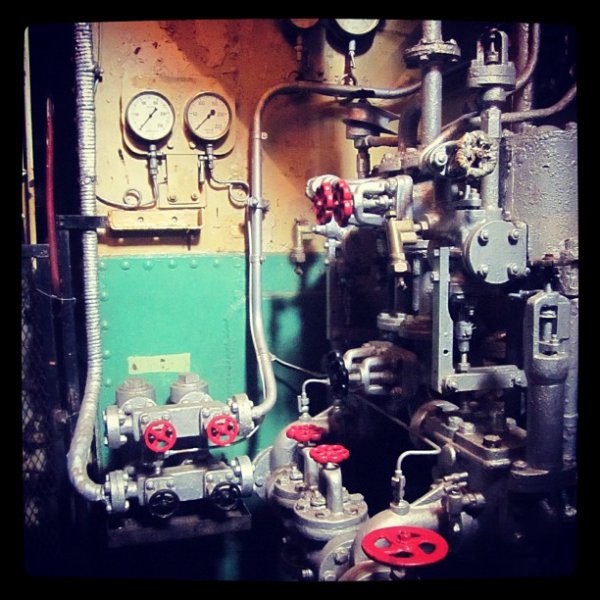
I > Qu’avons-nous en commun(S) ?
Part du secteur culturel considérée à tort comme marginale ou excédentaire, la communauté des lieux intermédiaires se trouve au cœur de son renouvellement. Lieux autres, ils composent, entre public et privé, un tiers-secteur dont la taille grandit rapidement. Selon leurs modes propres, ils explorent de nouvelles territorialités, à la fois culturelles, urbaines et sociales. Leurs acteurs se reconnaissent au souci de produire et de partager des commun(s), dans leurs rapports au lieu, à l’œuvre et au public. C’est leur capacité d’intermédiation qui les définit comme « intermédiaires  » : à l’intérieur du champ culturel, ils tracent des passages et des continuités entre disciplines – street art, marionnettes, design, peinture, musique amplifiée, danse, art numérique... –, entre acteurs – administrateurs, techniciens, artistes, porteurs de projet, amateurs, habitants... En dehors, ils ouvrent des lignes de fuite du champ culturel vers d’autres : par leurs pratiques fortement territorialisées, ils croisent autour des enjeux de la ville sensible, les mondes de la recherche, de l’urbanisme et de l’architecture ; fabriques de commun(s), ils explorent des modalités nouvelles d’agir, dans les champs de l’économie, de la politique et de la culture.
La solidité d’une telle communauté dépendra de sa capacité à serrer au plus près ce contre quoi elle se constitue, de même qu’en dépendra sa capacité à porter une parole commune.
Ce à quoi nous résistons peut être nommé assez simplement : la marchandisation de la culture. Nous opposons à la valeur d’échange du produit culturel, l’irréductible de nos pratiques et des agencements singuliers qu’elles produisent. Ainsi, de manière classique (au sens précis d’une certaine perfection formelle), nous incarnons dans l’espace culturel cette résistance de la valeur d’usage à sa transvaluation en valeur d’échange. Nous ne sommes pas les seuls : au dedans comme en dehors du secteur culturel, nos agencements, certes minoritaires, sont néanmoins pluriels.
Quel est le mode de cette résistance ? On peut dire de nos pratiques qu’elles insistent [1].. L’insistance de nos pratiques est à penser dans le double aspect de toute action : toute action peut s’envisager tant comme la mise en œuvre d’une pratique que sous l’angle de son résultat – comme production d’un effet ; comme praxis ou comme poiésis, selon Aristote.
(...) envisager l’action sous l’aspect de son résultat ne fait pas disparaître la possibilité de l’envisager dans son mouvement propre, sous l’aspect d’une pratique – c’est là l’enjeu d’une poétique des lieux intermédiaires.
C’est bien entendu depuis le poà¯étique, sous l’aspect du résultat de l’action, qu’opère la logique de la transvaluation : c’est ce qui permet d’en faire une "production", de l’intégrer dans un appareil productif, en tant que produit - bientôt, en tant que marchandise. Néanmoins, envisager l’action sous l’aspect de son résultat ne fait pas disparaître la possibilité de l’envisager dans son mouvement propre, sous l’aspect d’une pratique – c’est là l’enjeu d’une poétique des lieux intermédiaires.
Or, l’entrée par la praxis éclaire l’action d’un tout autre point de vue, qui est celui de la conduite de l’action, dont le régime spécifique est l’éthique. Si celui-ci persiste au-delà du devenir-produit de l’action, c’est qu’il ne répond pas tant à un type d’action particulier, qu’à un aspect selon lequel peut toujours s’envisager l’action : pour toute action, se constituent à la fois des modes d’agir et un effet de l’action. On ne peut l’un sans l’autre. Ces deux aspects ne s’opposent pas autrement que les deux faces d’une même pièce, le recto et le verso de la feuille, le revers signifiant de tout signifié.
C’est pourquoi l’opération de transvaluation de toute chose en valeur d’échange est un fantasme. On peut observer à l’œuvre dans tous les domaines une telle tentation totalitaire de la valeur économique : c’est la tentation de la valeur positive, forme renouvelée d’un positivisme qui n’a jamais été seulement une question de connaissance, mais d’abord un problème moral : que disparaisse tout revers, toute ombre, tout double dans Sa lumière unique. Un seul maître mot, un seul pur signifié, une explication parfaitement univoque de toute chose, dans une langue débarrassée de toute ambiguà¯té, de toute incertitude - de tout irrégularité. Il serait amusant de voir le marché tenter de réaliser cet idéal des Lumières : le triomphe de la Raison, si cela ne s’accompagnait d’une distorsion monstrueuse et perverse de la Raison elle-même. Cela dit, qui mieux que la valeur économique – ce pur moyen – saurait mettre en œuvre cette finalité sans fin de la raison dans son exercice permanent ? Car la raison ne saurait être pour elle-même autre chose qu’un moyen d’agir : ni un commencement, ni une fin. Ainsi, nul outil du côté de la raison pour juger de la valeur éthique d’une action, ni pour la motiver – au contraire, seul ce qui m’éveille au chant me fait agir : l’éthique regarde du côté de l’esthétique.
Longtemps, dans la philosophie classique, le régime de la praxis a été le propre de l’action politique. Les choses ont bien changé, comme le pointait Annah Arendt : on ne juge plus aujourd’hui d’un homme politique par les vertus qu’il manifeste dans l’action, mais sur ses résultats. A l’inverse, l’art au XXè siècle a déplacé son centre de gravité de l’œuvre vers la démarche. Avec le moment conceptuel, puis performatif, la peopolisation de l’art, l’emphase autour de l’artiste-icône venue remplacer l’emphase ancienne et romantique autour du génie, figure tardive de l’artiste-artisan (dont les vestiges perdurent néanmoins comme mythologie à destination de la valeur elle-même) : on ne peut plus ignorer l’importance de la conduite de l’artiste dans la valeur de l’œuvre.
Sous les formes les plus radicales, non seulement l’œuvre est déconstruite, mais l’artiste lui-même perd son nom. Aux tendances manifestées à la pointe d’un art alors nommé d’"avant-garde", et très largement engagé dans l’idée révolutionnaire propre au grand XXè siècle, il faut faire correspondre les effets induits par la culture de masse sur ce qui se constitue déjà alors comme un large marché des produits culturels : l’art dit « populaire  ». On constate alors un curieux effet de synergie, au terme du cycle, entre ces deux formes classiquement opposées de l’art : la forme élitaire et la forme populaire. Warhol a bien incarné, en en faisant l’objet de son œuvre, cette possibilité synthétique dont l’agent véritable est le marché (et non les politiques culturelles, dont la prétention à ce titre a servi de cache-misère à l’absence d’un projet politique sérieux pour la gauche au moment douloureux de la fin des utopies). Warhol réalise ainsi ce moment de réflexivité du marché de l’art, découvrant en soi la possibilité d’une transvaluation dans "l’économie réelle" de toute vie culturelle, alors encore à l’orée de son déploiement.
Le changement de structure économique ayant permis de faire de tout fait culturel un bien marchand, soit d’intégrer la sphère des activités culturelles dans le fonctionnement standard de l’économie dite des biens et services, est ce qui fut identifié par Fredric Jameson comme caractéristique inaugurale du postmodernisme, dans les années 70. Les trente années suivantes sont marquées par le temps long de la réorganisation des institutions culturelles nécessaire à ce nouveau régime de la valeur esthétique - à son intégration dans la sphère de l’économie marchande, à sa "normalisation", pourrait-on dire (c’est d’ailleurs pourquoi l’entretien du discours de l’exception culturelle, en France, à quelque chose d’hypocrite et d’à la fois délicieusement suranné).
Cette transformation sociale de la situation de la culture et de ses agents correspond à un assujettissement rigoureux des détenteurs du "capital culturel", comme à une prolétarisation des pratiques artistiques : enrôlement de la créativité au service de la productivité.
Nous sommes le fruit de cette histoire.
Nos pratiques n’insistent ni sur les fins ni sur les moyens de l’action, mais leur insistance est en soi retour du mode de l’agir comme puissance propre, indépendamment de son résultat. Elles ont pour effet une persistance de la question éthique par-delà la rationalité économique propre à la question de la production – elles ne s’y opposent pas, elles ne l’abrogent pas. Elles la redoublent. Elles font valoir qu’il est un revers à la question de la production de biens culturels – un revers à l’industrie de la culture : que la question du mode de l’action perdure par-delà le résultat, comme puissance d’agir.
L’insistance de la pratique pose la question des modalités de l’action, la question des manières de faire. Nous ne les questionnons pas : nous sommes l’insistance de la pratique comme caractère indépassable de la question.
II > A quoi aspirons-nous ?
Dans le jargon du secteur culturel, la notion de « paysage artistique  » se réduit trop vite aux professions qui le constituent – et nous contribuons nous-même, acteurs de ce paysage, à produire cet enfermement dans le désir où nous sommes, légitime, certes, de gagner notre vie.
Le grand perdant de cet effet de forclusion, c’est l’art lui-même. Car, comme l’ont compris les romantiques allemands, l’art ne peut jamais être plus que le moment où se dit à elle-même une culture comme esprit d’un peuple : il y a des cultures sans art, pas d’art sans culture. Il y a absolument un précédent de la culture sur l’art. La culture, suggère Michel Foucault en marge d’un cours au collège de France consacré à la question du « souci de soi  », pourrait s’entendre comme un ensemble de pratiques par lesquels le sujet se produit lui-même, la culture pourrait s’entendre comme l’ensemble des « techniques de soi  ».
Ni l’art ni l’artiste ne sauraient être les phares d’une telle culture : seulement des manifestations, des moments de son affirmation ou de sa saisie collective. L’histoire de l’art contemporain est d’ailleurs traversée par ces tentatives des artistes eux-mêmes pour mettre en crise l’ensemble des valeurs qui sous-tendent un ordre esthétique confiscatoire : le soi-disant « monde  » de l’art.
Or, c’est précisément la saisie d’un tel moment culturel qui me paraît être l’enjeu principal derrière la montée en puissance de nos lieux d’expérimentations – et derrière la mise en commun de nos expériences, c’est la perspective d’un nouvel agencement des politiques culturelles qui se dessine. Je veux dire par là que nous pouvons être la pression nécessaire sur le politique pour qu’il transforme et adapte sa manière aux nouvelles réalités du fait culturel dans nos sociétés contemporaines.
Derrière la mise en commun de nos expériences, c’est la perspective d’un nouvel agencement des politiques culturelles qui se dessine. Je veux dire par là que nous pouvons être la pression nécessaire sur le politique pour qu’il transforme et adapte sa manière aux nouvelles réalités du fait culturel dans nos sociétés contemporaines.
Ainsi, la question qui nous est posée me paraît, plutôt qu’à un paysage artistique, être celle de nos relations aux industries culturelles, dont une part sont du secteur public. Or, il y a dans le secteur culturel comme dans d’autres secteurs d’activité, des gens qui entendent promouvoir d’autres modèles productifs, d’autres manières de faire. Des manières plus coopératives, moins verticales, plus transversales. Il y a l’ESS, il y a les alter-mondialistes, il y a les indignés, l’agriculture raisonnée, les études post-coloniales, les militants LGBT, les squatteurs... Il est là , notre environnement naturel : voilà où nous sommes. Voilà notre histoire.
C’est pourquoi il me paraît singulièrement réducteur de se contenter d’interroger la place que l’on pourrait prendre dans un paysage artistique dont l’appellation même suggère une manière de rendre les armes avant d’avoir tiré un coup de feu. Un paysage, le monde de l’art ? Bien plutôt un champ de bataille !
Travailleurs parmi d’autres, nous voulons produire autrement. Or les évolutions de nos moyens de production rendent cet autrement possible.
La transformation en profondeur de nos sociétés qu’a provoquée la production massive de contenus (images, informations, données...) a changé la manière même dont nous faisons culture. Le culturel a été aspiré dans le champ de l’économie standard : cette transformation a entraîné une normalisation de l’économie de la culture (cf. la déclaration sur la diversité culturelle de l’UNESCO dont l’effet paradoxal est d’officialiser le devenir-marchandise de la culture, en tâchant de s’y opposer : "Article 8 - Les biens et services culturels, des marchandises pas comme les autres " – et cela me paraît vrai même en France, où l’idée d’"exception culturelle", qui prétendait également lutter contre la transvaluation de l’art en marchandise, a finalement seulement réussi à garantir la haute valeur des marchandises culturelles françaises). Une conséquence imprévue de cette normalisation, pourvu qu’on veuille en prendre acte, c’est ce que ces biens singuliers peuvent faire à l’économie classique à laquelle ils ont été intégrés, de par leur nature même. Considérer la culture sous l’angle de la production de biens nous conduit en effet à nous interroger sur ces biens d’une nature étrange que sont les biens culturels. Car, comme toute connaissance, ce sont des biens qui se partagent sans perte – qui appellent donc à la liberté d’usage et de circulation, comme ils relèvent d’une fabrique sensible du commun.
En même temps que la mécanique économique tâche d’intégrer cette nouvelle donne (c’est à dire, en l’état actuel des choses, de l’empêcher d’advenir), nos manières de faire se transforment, de sorte que nous n’avons pas seulement changé de culture : c’est l’idée de ce qu’est une culture qui a été transformée – la manière dont elle se produit, ce en quoi elle consiste. La culture n’est plus nationale. Elle n’est plus le grand récit d’une origine, un enchâssement de traditions transmises à la verticale, dans une Histoire unique. Les unités de lieux et de temps de la culture ont sauté.
Ce qui fait commun, dans la culture, ce n’est plus le passé (le passé commun), c’est ce que nous faisons ensemble, ce que nous avons en commun(s) : ce n’est plus une origine, c’est un avenir. La culture est désormais le fait des rencontres que nos trajectoires construisent, au sein de réseaux mondialisés d’échange – singulier-pluriel, elle est l’interculturalité produite par nos nouvelles urbanités (cf. Eric Corijn et l’exemple Bruxellois).
Nous sommes porteurs de cette modernité : du point de vue culturel, nous en sommes les lucioles (cf. G. Didi Huberman) sinon les phares. Les manières de faire qui sont propres à cette modernité, et dont le désir d’appropriation se répand dans le corps social – la participation, le partage sans perte, la logique contributive, les organisations a-centrées, la transversalité... – nous constituent intimement. Elles répondent aux enjeux des grandes urbanités contemporaines : comment vivre ensemble entre gens si différents, de cultures si différentes ?
Incidemment, ce changement de géométrie produit un effet d’importance : notre interlocuteur politique le plus important n’est plus l’Etat, car ce sont les villes, les communautés d’agglomération, les collectivités territoriales, qui sont les mieux placées pour saisir de tels enjeux de politiques culturelles – pour en avoir l’intelligence, comme pour savoir les mettre en œuvre.
Cela dit, revenons à la question de ce que nous voulons : négocier une place dans le susnommé paysage artistique ? Ou bien le transformer ?
Si nous voulons y prendre place, nous nous ferons beaucoup d’ennemis. Mais si nous entendons le bouleverser, nous aurons également beaucoup de sympathisants.
Jules Desgoutte, membre du collectif ABI/ABO,
pour le réseau ARTfactories/Autre(s)pARTs
[1] Dans "IN VIVO, lieux d’expérimentations du spectacle vivant", Pascal Nicolas le Strat, sociologue, dit de nos pratiques non seulement qu’elles résistent, mais qu’elles persistent, mais qu’elles insistent
Auteur : Jules Desgoutte (collectif Abi/Abo) pour ARTfactories/Autre(s)pARTs





